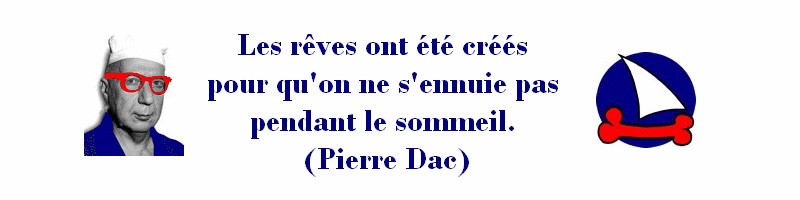Côté personnel
Côté personnel  No Comments
No Comments Les volutes de fumée du jardin de la rue Yantra
 Dans le petit jardin de la rue Yantra, au numéro 10, je fumais des cigarettes слънце … soleil en bulgare.
Dans le petit jardin de la rue Yantra, au numéro 10, je fumais des cigarettes слънце … soleil en bulgare.
Paquet plat en carton blanc, orange et gris qui ressemblait un peu aux Karelia que je rapportais de Grèce. Petites clopes sans filtre, à peine cylindriques, aplaties, tabac des manufactures populaires, mâtiné de saveurs orientales.
Je fumais en tournant en rond dans le jardin, songeant au lendemain, à notre école que nous bâtissions au jour le jour dans cette Bulgarie des années d’avant la chute du mur, du prochain coup fumant qui nous procurerait encore plus d’élèves.
Je rêvassais à la prochaine échappée vers un coin insolite des Balkans ou à l’exploration d’une île perdue dans le bleu de l’Egée, à l’ombre des oliviers, à la recherche des futs de colonnes à moitié enfouis d’un temple oublié dans la campagne méditerranéenne stridulante. La Grèce était alors notre bouffée d’oxygène, la destination de ces escapades qui nous permettaient de supporter les joies du paradis rouge…
Je fumais mes cigarettes soleil et Bolcho le teckel fouissait frénétiquement la terre du petit jardin, relevant la tête soudainement, les oreilles dressées, à l’écoute des moindres bruits de la ville pourtant bien atténués dans cette petite rue grise et paisible.
Les mélodies répétitives du professeur de piano du deuxième étage s’égrenaient à travers les fenêtres ouvertes. L’air était doux, les volutes bleues de mes cigarettes se perdaient dans le soir qui tombait.
Il était temps de rentrer, de gravir les trois étages de retrouver Marie qui nous attendait, le chien et moi, dans notre petit appartement.
C’est alors que, bien souvent, je croisais les vieilles comtesses, nos voisines de l’immeuble mitoyen. La mère et la fille, naufragées des tourmentes de l’histoire, aristocrates de la vieille Russie ayant fui les fureurs, le fracas et les fusillades bolcheviques de l’octobre rouge de la grande révolution. Réfugiées pour un temps dans le havre paisible d’une Bulgarie encore blanche… Las, rattrapées par le tourbillon de ce terrifiant vingtième siècle, la vague révolutionnaire submergeant à son tour les Balkans dans les affres d’une nouvelle guerre, encore plus sanglante, encore plus purificatrice.
Les deux vieilles dames s’exprimaient dans un français suranné mais délicieux, ultimes bribes de cette éducation d’un autre siècle, dispensée sous la férule de ces précepteurs et de gouvernantes venus de cette France qui fascinait encore les élites d’un monde désormais disparu .
Ils étaient quelques uns encore dans la Bulgarie communiste, russes blancs ayant renoncé à fuir plus avant, rattrapés par l’histoire, résignés et intégrés dans un nouvel ordre social.
Andrei, chauffeur d’un des bus de notre école française, colosse tiré à quatre épingles, francophone lui aussi, était également un authentique « graf », petit fils d’un comte de la cour du Tsar, de cette lignée des chauffeurs de taxis parisiens, princes russes exilés…